<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p><span>Les notions abordées dans cette fiche dépassent celles qui sont vues au secondaire. Il s'agit ici d'un complément pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus.<br>
<br>
<a href="/fr/eleves/bv/sciences/le-systeme-lymphatique-et-son-anatomie-s1275">Le système lymphatique</a></span></p>
</body></html>
Les vaisseaux lymphatiques contiennent un liquide que l’on nomme la lymphe. Celle-ci est composée du liquide interstitiel en circulation, ainsi que de liquide provenant du foie et des intestins. Les vaisseaux lymphatiques sont disposés de telle sorte que la lymphe voyage à sens unique des capillaires sanguins vers le cœur.
Les principales cellules que l’on retrouve dans la lymphe sont les lymphocytes. Bien qu’ils soient très répandus dans l’organisme, les vaisseaux lymphatiques sont toutefois absents des dents, des os, de la moelle, du myocarde et du système nerveux central (l'absence des vaisseaux lymphatiques dans le système nerveux central est remise en question suite à une découverte du printemps 2015).
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><p>Les capillaires lymphatiques sont les structures les plus en amont du réseau lymphatique. L’extrémité de ces capillaires se termine en cul-de-sac. Ces capillaires s’infiltrent ainsi dans les cellules et les capillaires sanguins des <a href="/fr/eleves/bv/sciences/les-tissus-et-les-organes-s1249">tissus conjonctifs lâches</a> de l’organisme. Leur extrémité est très perméable notamment en raison des <strong>disjonctions de la membrane </strong>(tels des bardeaux de toiture qui auraient été installés à l’envers). Cette disposition structurale agit un peu comme une valve où les jeux de pression externe et pression interne laisseront entrer le liquide de l’extérieur vers l’intérieur. Lorsque la pression externe augmente, les disjonctions s’ouvrent et inversement, elles se fermeront lorsque la pression interne sera plus forte.</p>
</body></html>
Les vaisseaux chylifères sont des capillaires lymphatiques hautement spécialisés que l’on retrouve dans l’intestin, plus précisément dans les villosités de la muqueuse. Ils transportent la lymphe issue des intestins que l’on nomme le chyle. Ces vaisseaux jouent d’ailleurs un important rôle dans l’absorption des lipides.
Ces vaisseaux collecteurs sont en aval des capillaires lymphatiques et reçoivent la lymphe de ces derniers. Leur structure est plutôt semblable à celle des veines. Cependant, ils contiennent beaucoup plus de valvules. De plus, les trois couches de leur membrane sont beaucoup plus minces et ils forment un grand nombre d’anastomoses, des connections entre des vaisseaux de même type (un réseau).
Alors que les vaisseaux lymphatiques superficiels sont plutôt parallèles aux veines, les vaisseaux lymphatiques profonds suivent les artères en formant des anastomoses autour d’elles.
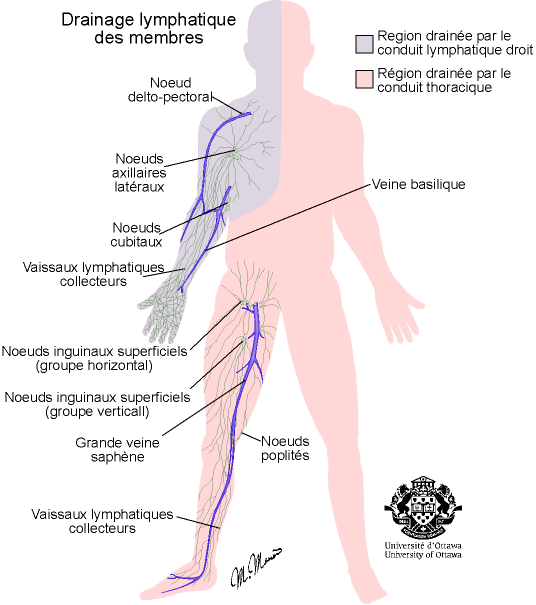
D’un diamètre encore plus grand que les vaisseaux lymphatiques, les troncs lymphatiques sont constitués de la jonction des vaisseaux lymphatiques collecteurs en un plus gros.
Ces troncs reçoivent la lymphe des vaisseaux en amont afin de drainer des régions étendues de l’organisme. Les troncs viennent par paire pour la plupart : lombaires, broncho-médiastinaux, subclaviers et jugulaires. Toutefois, le tronc intestinal est unique. Les noms des troncs sont habituellement grandement inspirés de la région d’où provient la lymphe.
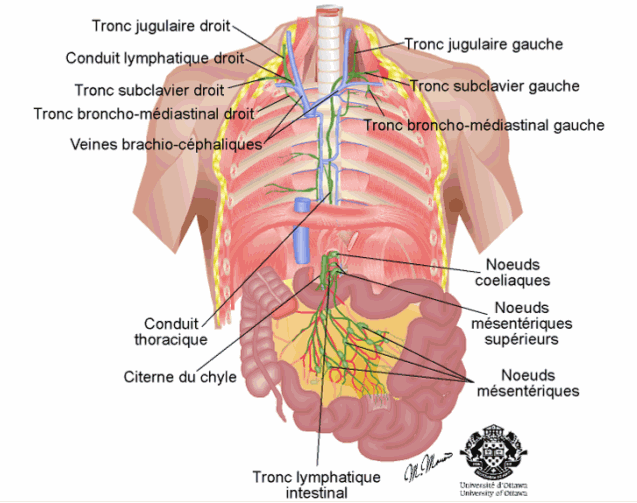
Toute la lymphe en circulation aboutit dans deux gros conduits: le conduit lymphatique droit et le conduit thoracique.
Le conduit lymphatique, plus petit, accueille la lymphe provenant du bras droit, ainsi que celle de la partie droite de la tête et du thorax.
D’autre part, le conduit thoracique accueille la lymphe du reste du corps. Il est par conséquent plus gros. Il débute juste en avant des premières vertèbres lombaires sous la forme d’un sac que l’on nomme la citerne du chyle (ou la citerne de Pecquet). La lymphe provenant du tronc intestinal et des deux troncs lombaires (qui draînent la lymphe des membres inférieurs) sera recueillie par la citerne du chyle. Le côté gauche du thorax et de la tête, ainsi que le bras gauche verront leur lymphe recueillie au cours de la progression du conduit thoracique vers la partie supérieure du corps. Ces deux conduits déverseront alors leur contenu en lymphe dans le système veineux, et ce chacun de leur côté. La veine visée sera alors la veine subclavière, à l’endroit où se joint la veine jugulaire interne.
Les principaux organes lymphatiques (et les plus connus) sont les nœuds lymphatiques communément appelés les ganglions.
Ces derniers sont dispersés tout au long du système lymphatique, bien que l’on retrouve certaines concentrations de ganglions au niveau du cou, des aines, des aisselles et de la cavité abdominale. À ces endroits, ils sont suffisamment gros et près de la surface pour être perçus au toucher.
Les nœuds lymphatiques se comptent par centaines et leur taille varie entre 1 et 25 mm. Ils ressemblent à des graines de haricot.
Les autres principaux organes lymphatiques sont les amygdales, la rate, le thymus et les follicules lymphatiques.
Les amygdales sont situées dans la région du pharynx et sont généralement les organes lymphatiques dont la structure est la plus simple. Elles s’infectent souvent, ce qui explique qu’elles sont souvent retirées chirurgicalement.
La rate est le plus gros organe lymphatique. Elle est très vascularisée et située à gauche de l’estomac.
Le thymus est surtout actif dans les premières années de la vie. Il devient par la suite peu actif. Il est situé dans le thorax, entre les poumons, et il recouvre partiellement la partie supérieure du cœur.
Enfin, les amas de follicules lymphatiques (aussi appelées plaques de Peyer) sont situés sur le pourtour du petit intestin et possèdent une structure semblable à celle des amygdales. Un autre amas se trouve dans la paroi de l’appendice.
Le rôle premier de la lymphe est d’ordre immunitaire. C’est d’ailleurs ce qui vaut leur nom aux globules blancs qui participent à la défense de l’organisme (l’immunité) : les lymphocytes.
En pénétrant dans le système lymphatique, tout antigène (toute particule étrangère à l’organisme tels que les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, les érythrocytes incompatibles, etc.) sera attaqué par les lymphocytes T ou B, ou encore par les phagocytes (ceux faisant de la phagocytose).
Dans un nœud lymphatique, plusieurs types de cellules se combinent pour créer un piège à corps étranger semblable à une toile d’araignée. La charpente du nœud (le stroma) est produite par les cellules réticulaires. Cette charpente soutient les lymphocytes T et les cellules dendritiques qui activent la réponse inflammatoire et qui peuvent s’attaquer directement aux cellules étrangères et les détruire.
D’autre part, les lymphocytes B donneront naissance aux plasmocytes qui sécrètent les anticorps nécessaires à l’inhibition de l’action des antigènes, et ce jusqu’à ce que ceux-ci se fassent phagocyter par les macrophages.
La lymphe sert donc de site de développement aux lymphocytes en les abritant et en leur offrant une position stratégique pour anéantir les attaques des cellules infectieuses.
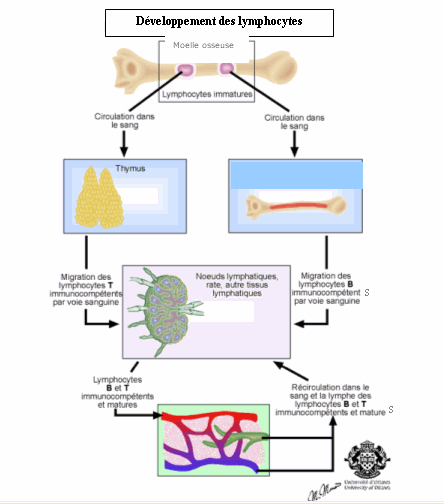
Le second rôle est lié au drainage du liquide interstitiel. Ce drainage évite les accumulations d’œdème, ce qui limite les infections et l’enflure. Il y a alors une meilleure répartition des liquides interstitiels à travers l’organisme. Ainsi, les équilibres osmotiques entre les tissus et le sang sont possibles.
Le système lymphatique ne possède pas de système de pompe, contrairement au sang artériel que possède le cœur. De plus, la pression y est habituellement assez faible, ce qui limite la possibilité d’utiliser un gradient puissant de pression.
Le mode de propagation utilisé par le système lymphatique ressemble davantage à celui du retour veineux. En effet, il y aura d’abord le mode de propulsion impliquant les muscles, le squelette, le péristaltisme et la respiration. Grâce aux mouvements du corps, les vaisseaux lymphatiques seront compressés et décompressés, ce qui fera office de pompe. Ceci fera changer la lymphe de compartiments, ceux-ci étant limités par des valvules qui empêchent le reflux. Aussi, une certaine utilisation de la pression provenant du liquide interstitiel servira à faire avancer la lymphe. Certains vaisseaux lymphatiques, étant accolés aux artères, se retrouveront dans la même gaine de tissus conjonctifs. Ainsi, la pulsation dans les artères provoquera des changements de pression qui entraîneront un déplacement de la lymphe. Enfin, les conduits lymphatiques et les troncs lymphatiques peuvent s’adonner à des contractions rythmiques faisant progresser la lymphe dans les vaisseaux, même si ce mécanisme est moins important que les contractions dues au système musculo-squelettique.
L’objectif d’un nœud lymphatique, et ce qui lui a probablement valu son nom, est de contenir la lymphe suffisamment longtemps pour que les lymphocytes aient le temps d’agir.
En fait, il y a plusieurs vaisseaux afférents (qui entrent) et un seul vaisseau efférent (qui sort). Le centre du ganglion (noeud) est une sorte de sinus où est retenue la lymphe. Ainsi, il se crée comme un bouchon de circulation, ce qui fait stagner la lymphe dans le ganglion. Les lymphocytes ont alors le temps de purifier en partie la lymphe de ses agents infectieux. Cependant, il y a généralement plusieurs nœuds voisins dans un même circuit, ce qui permettra d’ailleurs de purifier la lymphe au maximum en passant par plusieurs de ces nœuds.